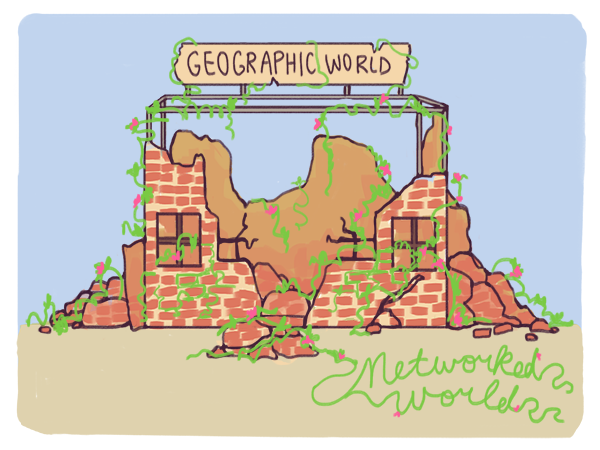Bien sûr, mettre à jour l’ordinateur planétaire est bien plus compliqué que de changer de smartphone. Pas étonnant donc qu’on ait déjà pris presqu’un demi-siècle et qu’on ne soit pas encore au bout de nos peines.
Depuis 1974, l’année du pic de centralisation, nous passons d’un monde organisé autour des atomes et de la géographie à un monde organisé autour des bits et des réseaux. Tout cela se fait à la manière d’une vigne vierge poussant sur une vieille maison : elle se glisse dans la moindre fissure pour établir une nouvelle logique architecturale.
La différence entre les deux mondes est simple : le monde géographique résout les problèmes en recourant à une logique d’objectifs, qui sont autant de conflits territoriaux à somme nulle, qu’ils soient réels ou symboliques. Le monde des réseaux résout les problèmes par la sérendipité en s’appuyant sur des innovations qui battent en brèche les certitudes quant à la façon d’utiliser les ressources, typiquement en les rendant moins concurrentes et par là même étonnamment abondantes.
Bien entendu, résoudre les problèmes par la logique d’objectifs, c’est s’appuyer sur le syllogisme des politiciens : il faut faire quelque chose ; voilà précisément quelque chose ; c’est précisément ce qu’il faut faire. Ce genre d’objectifs découle habituellement des différences entre la réalité et les visions des utopistes. Les solutions découlent du principe déterministe selon lequel la forme suit la fonction1, qui est apparu au début du XXe siècle avec les modernistes autoritaires. Voici à peu près à quoi ressemble ce processus dans sa forme la plus simple :
- Choix du problème : choisir un problème clair et important,
- Affectation des ressources : s’accaparer les moyens en promettant de le résoudre,
- Solution : résoudre le problème en restant dans les limites promises.
Ce modèle est tellement connu qu’il est devenu synonyme de « résolution de problème ». Il est très difficile d’imaginer comment la résolution de problème pourrait se faire autrement. Mais ce modèle constitue également une revendication territoriale déguisée. La gravité d’un problème pose également les limites de l’autorité qu’on revendique. S’accaparer des ressources revient à se lancer dans un jeu à somme nulle pour apporter de l’eau à votre moulin et les rendre captives. Résoudre un problème revient généralement à atteindre les effets promis à l’intérieur du cadre fixé, sans considérer ce qui se passe en-dehors. Cela revient à ignorer les effets collatéraux – ce que les économistes appellent les coûts sociaux – en particulier ceux qui touchent les plus faibles.
Puisque nous avons déjà analysé les limites de cette approche dans les chapitres précédents, nous n’allons que les résumer ici. S’attaquer à un problème en se fondant sur son « importance » revient à accepter sans réfléchir les priorités et les méthodes du pastoralisme. Faire entrer la solution dans une « vision » séduisante de la réussite, c’est limiter les possibilités créatives des générations futures. Les possibilités d’innovation sont considérablement réduites : on ne peut pas s’appuyer sur des idées imprévues qui permettraient de résoudre des problèmes différents avec les même ressources, ni encore moins suivre la direction de l’intérêt maximal indéfiniment. Autrement dit, les coûts d’opportunité cachés peuvent se révéler plus importants que les bénéfices visibles. On ne peut pas non plus explorer des solutions qui demanderaient des ressources différentes (et certainement moins coûteuses) que celles qu’on s’est battu pour obtenir : la résolution des problèmes est une figure imposée.
Ce processus ne s’accommode pas bien de l’incertitude ou de l’ambiguïté. Même l’incertitude positive2 devient un problème : un excédent budgétaire non prévu doit être dépensé toute affaire cessante, quitte souvent à le gaspiller, sans quoi le budget de l’année suivante risquerait d’être diminué. Des idées ou des informations nouvelles et imprévues, en particulier si elles proviennent de nouvelles perspectives – le moteur de l’innovation – sont négatives par définition et il convient de s’en débarrasser comme on le ferait d’interruptions non volontaires. Une nouvelle application pour smartphone non prévue par la réglementation existante doit être interdite.
Au cours du siècle dernier, la plupart des problèmes complexes résolus en se focalisant sur les objectifs furent des échecs.
Dans le monde connecté, la vision des choses se fonde sur une approche totalement différente. On ne commence pas par des objectifs utopiques ou des ressources qu’on s’accapare par des promesses ou des menaces.
Au contraire, on commence par un bidouillage pragmatique et ouvert qui profite de l’inconnu. Au premier abord, ça ne ressemble même pas à une méthode de résolution de problèmes :
- Immersion dans des courants de pensées, des réseaux et des capacités disponibles pertinents,
- Expérimentation pour découvrir de nouvelles possibilités en s’appuyant sur des essais et deserreurs,
- Taille critique pour diminuer les coûts de toutes les « bonnes surprises » qui fonctionnent bien.
Là où le syllogisme des hommes politiques se focalise sur la réparation de choses qui semblent cassées au regard d’un idéal intangible de perfection, la logique des bidouilleurs cherche avant tout des possibilités volontaristes de changement. Comme Scott Adams, le créateur de Dilbert3, a pu le noter : « les gens normaux ne comprennent pas ce concept ; les gens normaux croient que si ça marche, c’est qu’il n’y a rien à réparer. Les ingénieurs croient que si ça marche, c’est que ça ne fait pas encore assez de choses4 ».
Ce qui, dans une utopie immuable, passerait pour un changement apparemment inutile devient, dans un environnement changeant, une méthode permettant de garder une longueur d’avance. Ici se situe la différence clé qui sépare les méthodes de résolution de problèmes : dans l’approche par objectifs, l’idéation libre est vue comme fondamentalement négative. Dans le bidouillage, elle est positive.
La première phase – l’immersion dans des courants de pensées – peut prendre la forme d’une procrastination nonchalante sur Facebook ou Twitter et aussi de jeux futiles avec de nouveaux outils trouvés sur GitHub. Mais en réalité il s’agit de rester ouvert aux opportunités et aux menaces qui se font jour. Comme nous l’avons vu au cours des chapitres précédents, l’expérimentation perpétuelle se nourrit de bidouillage avec tout ce qui peut tomber sous la main. Très souvent, il s’agit de ressources que les processus à objectifs considèrent comme des « déchets » : un exemple de coûts sociaux devenus des atouts. Une grande partie de la science des données modernes, par exemple, a commencé avec des « données d’échappement5 » : des données sans utilité de court terme pour les projets à objectifs, et qui auraient normalement dû être détruites dans un contexte où le stockage coûte cher. Puisque le processus commence par des expérimentations à petite échelle, le coût des erreurs est naturellement limité. Les avantages, en revanche, ne le sont pas : grâce à ce levier inattendu, il n’y a pas de limite imposée aux usages que vous pourriez découvrir à ces nouvelles capacités.
Qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, les bidouilleurs qui disposent de ressources précieuses mais sous-utilisées ont tendance à se comporter de manière contre-intuitive. Au lieu de garder captives les ressources inutilisées, ils en ouvrent l’accès au plus grand nombre possible, et s’en détachent largement en espérant générer des externalités positives par de nouveaux bidouilleurs. Quand cela fonctionne, apparaissent des écosystèmes florissants fondés sur l’innovation ouverte et de solides nouveaux flux de richesses commencent à circuler. Ceux qui partagent de façon aussi ouverte des ressources uniques et intéressantes y gagnent un type de réputation que l’argent ne peut pas acheter. C’est comme cela qu’ont commencé le système d’exploitation Android de Google, les technologies big data, le kit d’expérimentation Arduino et le robot sous-marin OpenROV. Plus récemment, Tesla a volontairement ouvert l’accès aux technologies brevetées de sa voiture électrique de façon très large en comparaison des habitudes de l’industrie automobile.
Le bidouillage est un processus de recherche de sérendipité qui ne fait pas que tolérer l’incertitude et l’ambiguïté, il en a besoin. Quand toutes les conditions requises se combinent bien, il en résulte un effet boule de neige où l’on va de bonnes surprises en bonnes surprises.
Ce qui en fait un mécanisme de résolution de problèmes, c’est l’association entre la diversité des points de vue individuels et la loi des grands nombres (le principe statistique selon lequel la probabilité de survenance d’un événement rare augmente avec le nombre d’essais). Si un volume croissant d’individus de profils différents se comportent de la sorte, la probabilité de résoudre n’importe quel problème par des idées issues de la sérendipité va augmenter doucement. C’est la chance des réseaux.
Les solutions trouvées par la sérendipité ne sont pas seulement moins chères que celles issues de la méthode par objectifs. Elles sont également plus élégantes et plus créatives et demandent beaucoup moins de conflits. Il arrive qu’elles soient si créatives qu’il est difficile d’admettre qu’elles résolvent un problème déterminé. Le télétravail et la visioconférence, par exemple, font plus pour « résoudre » le problème de la dépendance aux énergies fossiles que la plupart des solutions employant les énergies alternatives ; et pourtant on les considère souvent comme des technologies qui facilitent les conditions de travail et non comme des solutions pour économiser l’énergie.
Les solutions nées du bidouillage ne visent pas certains problèmes particuliers, comme le « changement climatique » ou la « défense des classes moyennes », leur champ d’application est donc plus large. C’est pourquoi non seulement les problèmes présents sont résolus de façon créative mais une valeur nouvelle est également créée grâce au surplus du consommateur et aux externalités positives. Le signe le plus évident qu’une telle sérendipité est en marche est la rapidité étonnante avec laquelle on adopte une nouvelle possibilité. C’est ce qui indique que cette possibilité est utilisée de nombreuses manières, toutes aussi inattendues les unes que les autres. Elle résout à la fois des problèmes évidents et imprévus, qu’elle ait été prévue pour ça ou que ce soit un « coup de chance ».
En définitive, le rôle du capital-risque consiste à détecter au plus tôt de tels signes de sérendipité et d’y investir pour les accélérer. C’est ce qui fait de la Silicon Valley le premier écosystème à prendre la pleine dimension de la logique naturelle des réseaux, totalement et en conscience. Quand tout se passe bien, les ressources se dirigent naturellement vers n’importe quelle activité en croissance et qui génère de la sérendipité le plus rapidement. Mieux cela fonctionne et plus les ressources affluent, minimisant les coûts d’opportunité.
Vue de l’intérieur, la résolution de problème grâce à la sérendipité n’a rien que de très naturel. Du point de vue de ceux qui résolvent les problèmes par la méthode des objectifs, au contraire, cela peut paraître incompréhensible, allant du gaspillage à des motivations immorales.
Cette perception est avant tout due au fait que l’accès à la chance de réseaux suffisamment souples peut être ralentie par des séparations suffisamment fortes du monde géographique (ce qu’on appelle parfois la bahramdipité6 : la sérendipité contrecarrée par des forces suffisamment puissantes). Là où les ressources ne peuvent pas circuler librement pour accélérer la sérendipité, elles ne peuvent pas mettre à profit les solutions permises par la chance pour résoudre les problèmes ni créer de surplus du consommateur ou d’externalités positives. Il en résulte une différence de plus en plus importante entre le monde géographique et celui des réseaux.
A première vue, cette inégalité ressemble à celles qui existent à l’intérieur même du monde géographique et qui sont le fruit des dysfonctionnements des marchés financiers, du capitalisme de connivence et de la recherche des rentes de situation. C’est pourquoi il peut être compliqué pour les personnes non férues de technologie d’en appeler aux puissances financières et à la Silicon Valley, bien que ces deux entités représentent deux philosophies et deux approches radicalement différentes de la résolution de problèmes. Quand ces deux pôles s’opposent en termes particulièrement inégaux, comme ce fut le cas avec le secteur des technologies vertes à la fin des années 2000, les rentes de situation font des puissants du monde géographique une proie encore trop importante pour le logiciel.
Mais cette situation n’est que temporaire. A mesure que le monde en réseau continue à se développer, il faut s’attendre à des résultats très différents la prochaine fois qu’il s’attaquera aux problèmes des technologies vertes.
Etant données les erreurs et les limites qui vont naturellement de pair avec ses capacités balbutiantes, le monde des réseaux peut être perçu comme « inadapté » aux « vrais » problèmes.
Alors que le monde financier et la Silicon Valley peuvent souvent sembler sourds et insensibles aux problèmes pressants tout en consacrant des milliardaires avec une régularité de métronome, les causes de leur surdité respective sont pourtant différentes. Les problèmes du monde financier sont réels et symptomatiques d’une vraie crise de mobilité économique et sociale dans le monde géographique. Quant à ceux de la Silicon Valley, ils n’existent que parce que trop peu de gens sont encore connectés au monde des réseaux, ce qui limite sa puissance. La meilleure réponse à laquelle nous soyons parvenus pour le premier, c’est de renflouer périodiquement des organisations « trop grosses pour sombrer », tant publiques que privées. D’autre part, le problème de la connectivité se résout lui-même progressivement et avec sérendipité à mesure que les smartphones prolifèrent.
Les différences entre les deux approches de la résolution de problème se constatent également au plan macroéconomique.
Au contraire des hauts et des bas des marchés financiers qui sont souvent créés artificiellement, les hauts et les bas technologiques sont une caractéristique intrinsèque de la création de richesse elle-même. Comme Carlota Perez a pu le noter, les échecs technologiques peuvent tout à fait déboucher sur des nouveautés majeures qui n’avaient pas pu se développer au cours de périodes de croissance. Elles étendent massivement l’accès à la chance des réseaux à des populations plus larges. Ce fut notamment le cas lors de l’éclatement de la bulle technologique en 2000. L’accès aux outils de l’entrepreneuriat s’est massivement développé et cela a commencé à alimenter presque immédiatement la vague suivante d’innovation.
Née de la fraude et de la duperie, la crise des subprimes de 2007 n’avait pas permis de telles conséquences nées de la sérendipité. Elle a globalement détruit de la valeur plutôt qu’elle n’en a créée. La crise financière globale qui en a découlé est représentative d’une crise systémique plus large dans le monde géographique.
Précédent | Remonter | Suivant
[1] Ce principe a été édicté par l’architecte américain Louis Sullivan en 1896 et a débouché sur le mouvement fonc- tionnaliste en architecture.
[2] Sur l’incertitude positive, voir l’ouvrage de Gelatt et Gelatt, Creative Decision Making Using Positive Uncertainty: Second Edition, 2003 (ndt).
[3] Bande dessinée satirique dépeignant la vie au bureau (ndt).
[4] Citation tirée de Le principe de Dilbert, Scott Adams, éditions First, 1997 (ndt).
[5] L’auteur construit un jeu de mot en référence aux « gaz d’échappement ». Nous conservons cette construction (ndt).
[6] Litt. Bahramdipity, un néologisme formé sur Bahram Gur, tel que décrit dans Voyages et aventures des trois princes de Serendip et qui consiste à supprimer les découvertes issues de la sérendipité par la force. Nous proposons notre traduction de ce terme (ndt).